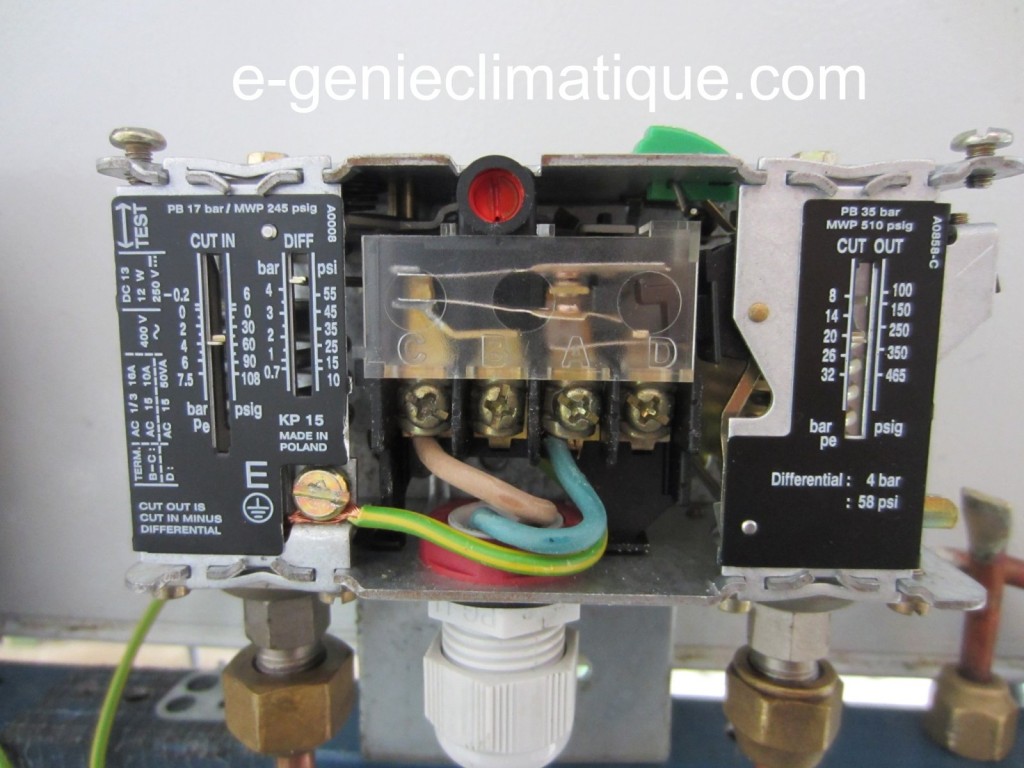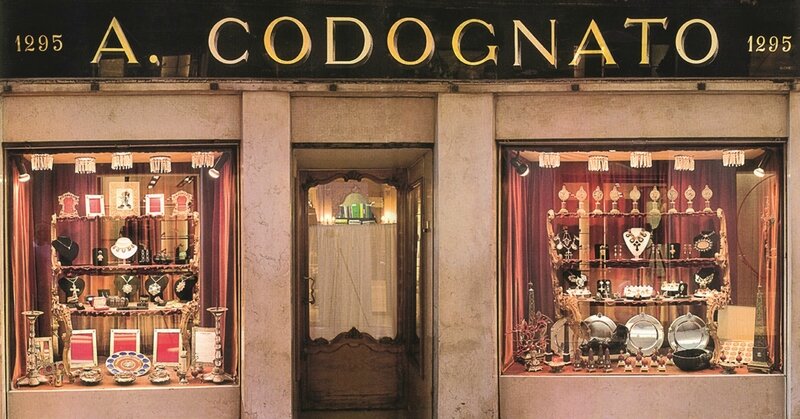Collaboration
Théâtre de la Madeleine
27 mars
Michel Aumont, Didier Sandre, Christiane Cohendy, Stéphanie Pasquet, Patrick Payet, Eric Verdin, Armand Eloi
Je ne connaissais pas grand-chose à Collaboration, les bons échos de ma famille et des amis m’ont poussé à y aller sans même connaitre le sujet. Abonné depuis quelques semaines des premiers rangs, je suis à nouveau très bien placé dans ce mignon Théâtre de la Madeleine. (Décidément je risque de m’habituer trop au luxe !) Une pièce qui parlait finalement d'un des grands thèmes qui animent ce blog : l’opéra, et, le plus important, sa création.

Nous sommes en 1930, Hofmannsthal, ami de Strauss et son librettiste (Rosenkavalier, Die Frau ohne Schatten, Elektra) vient de mourir. Le compositeur est désespéré, il veut continuer de composer, il vit pour composer. Il décide alors de contacter l’idole de sa femme, Stefan Zweig, pour qu’il rédige le prochain livret. Commence alors une collaboration qui mènera à la création de La Femme silencieuse, dont la première aura lieu à Dresde en juin 1935.
La thématique principale est celle du décalage de l’artiste dans son époque. Celui qui pense que l'histoire ne l'influencera pas, l'autre qui tente de défendre ses idéaux dans un monde en faillite. Strauss proclame qu’il a composé sous le Kaiser, sous Weimar, et qu’il continuera sous Hitler. Rien ne peut interrompre sa seule volonté de vivre : la composition. En face, le quasi-autisme du Zweig névrosé, fervent opposant à la violence qui ne peut vivre qu’en Europe. Strauss ne réussit pas à comprendre que le monde évolue. Il pense son influence inépuisable, que le monde ne change pas suffisamment pour asservir l'art. Deux hommes bien opposés qui pourtant s'entendent si bien et s'admirent respectivement.
Lors de la première de leur œuvre commune, Strauss se bat pour que le nom du librettiste soit écrit sur l'affiche. Le directeur de l'opéra sera par la suite démis de ses fonctions, l'opéra interdit plus de trois représentations. Strauss collaborera avec les nazis, devenant président de la chambre de musique du Reich, pour protéger sa belle fille juive et ses petits enfants. Il réussira à les protéger, mais non pas la famille de sa belle fille. L'idéaliste Zweig sera forcé de s'exiler, à Londres puis au Brésil où il se suicidera avec son assistante et amante, Lotte.
La pièce se découpe en plusieurs scènes espacées par le temps, de 30 a 45, d'une Europe encore dans les réjouissances et la naïveté de l'entre deux guerres à la reconstruction du Vieux Continent.
Mais ne vous y méprenez pas, cette pièce n'est pas pour autant une tragédie. A l'exception des dernières scènes, nous sommes presque dans une comédie. Nous prenons le point de vue du couple Strauss, bien insouciant en ce début de totalitarisme. Strauss est un homme jovial, un peu misanthrope mais d'une bonhommie très distrayante. Il est surtout accompagné de sa femme, Pauline, une ancienne soprano qui a gardé des airs de diva avec un franc parler et des manies bien marqués. Même lorsque l'officier nazi est présent sur scène, jusqu'à un certain moment, l'humour reste.
Sandre en Zweig semble très impliqué, dès la première scène nous apprenons qu'il est névrosé, et cela ne quitte ensuite pas le personnage. Gêné dès le début, il semble perdu dans un monde qui n'existe plus que dans sa tête, presque celui de la Société des Nations. (Je suis un citoyen de l'Europe) Il est accompagné de sa charmante assistance Charlotte (Lotte), qui est très émouvante dans ses quelques scènes.

Entre les scènes s'intercalent des airs opéra de Strauss, compositeur que je n'apprécie pas particulièrement, même si Capriccio m'a fait changer d'avis. J'ai néanmoins appris plusieurs choses: grand admirateur de Mozart dont il se considère l'héritier, de Wagner également, dont il dit qu'il a atteint les sommets de l'art.
C'est devant un homme affaibli par les coups répétés du régime nazi que nous nous trouvons dans la dernière scène, un vieil homme accompagnés de sa femme qui doit justifier son attitude avec les nazis devant un conseil de dénazification. Celui qui était vu comme le plus grand compositeur allemand de la première moitié du XXe siècle mourra quelques années plus tard.
Enfin, cette pièce permet aussi de comprendre le processus de création de l'opéra. Les échanges sur le thème de l’œuvre, la rédaction du synopsis, puis la longue réalisation des dialogues acte à acte, suivie par la composition de la musique.
Un thème très intéressant, un point de vue différent sur une période de l’histoire finalement assez connue et de très bons acteurs qui ont rendu cette soirée passionnante !